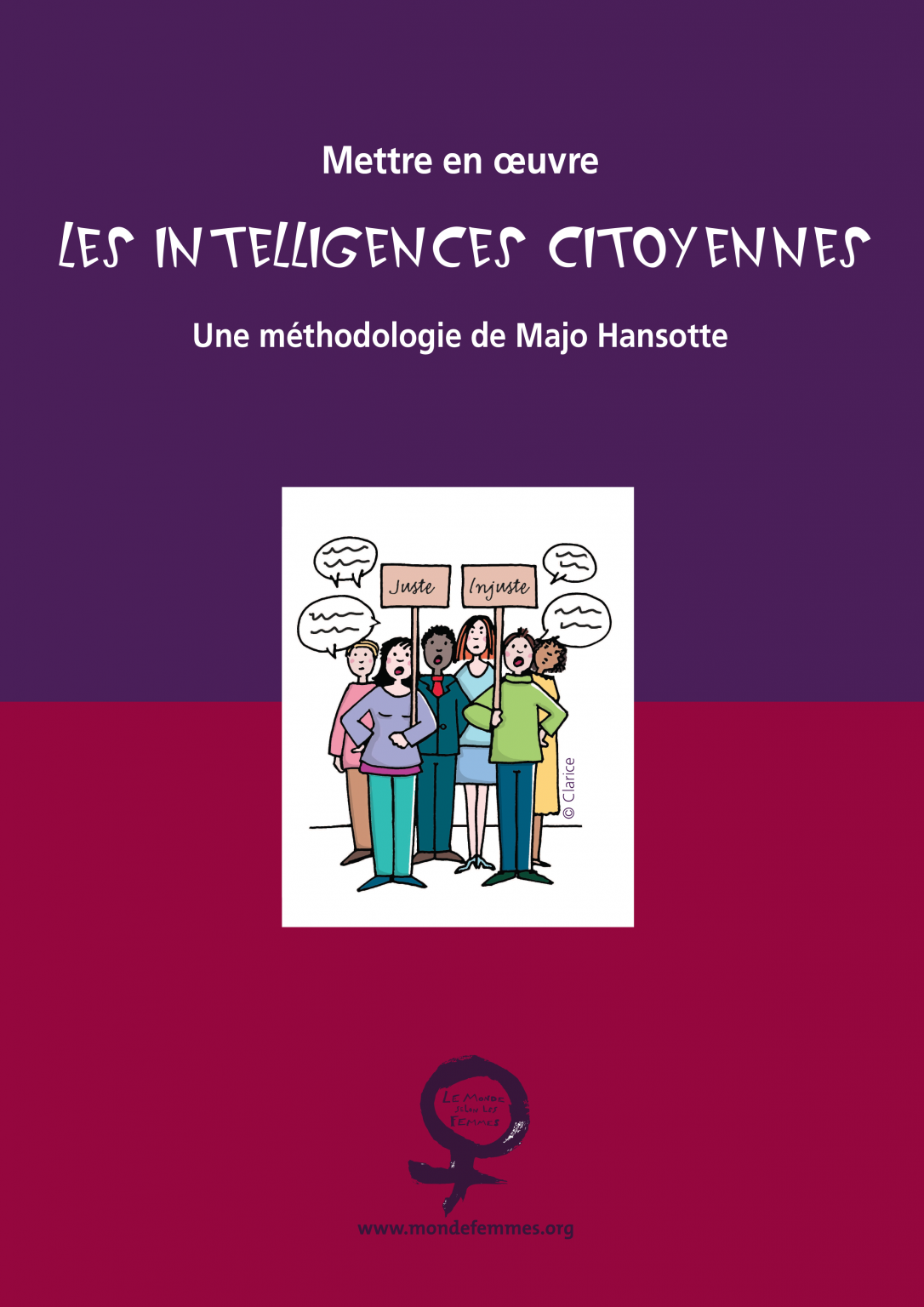© mario beauregard – Fotolia
Actions locales… Penser global ! Nous pouvons l’observer tous les jours, et dans beaucoup de domaines : les formes d’engagement et de mobilisation sont plurielles et « à géométrie variable » en fonction des contextes, des enjeux, des personnes, etc. Mais faut-il encore savoir de quel type d’engagement nous parlons ?
En effet, être « engagé » ne nécessite pas forcément de dynamique collective ou de revendication politique. À contrario, la mobilisation, elle, nécessite l’engagement de plusieurs personnes au travers d’une action commune au service d’une cause ou d’un changement. La mobilisation est donc une forme d’engagement bien spécifique.
La définition de ces deux concepts et leur modalités de mise en œuvre semble faire grand débat au sein des ONG, associations subsidiées pour « mobiliser », « sensibiliser », « rendre engagé », « émanciper », leur « public cible ». Pour ces institutions et leurs travailleur·euses, au-delà des mots clés, c’est bien souvent le sens de ces mobilisations qui est questionné ? Quel rôle ces acteurs sont-ils amenés à jouer dans les mobilisations citoyennes d’aujourd’hui ? Pourquoi, pour qui, avec qui et comment être engagé ? Faut-il d’abord, sensibiliser, former, mobiliser ? Pas facile de se « réinventer », de se redéfinir dans une société en mutation qui n’a de cesse de se complexifier.
La FUCID n’est, elle non plus, pas exempte de ces questionnements de fond quant à l’engagement des jeunes sur le campus avec qui elle travaille principalement mais également sur les formes de mobilisation actuelles. Par exemple, devant le caractère « aléatoire » de l’engagement et de la présence des jeunes comme moteurs aux activités que la FUCID propose, nous sommes parfois bien démunis quant aux réponses à y apporter. Dès lors, il nous apparaît nécessaire de faire un travail de réflexion et d’observation de nos pratiques professionnelles au regard d’outils méthodologiques pensés à partir de d’expériences de mobilisation concrètes.
Au travers de cette courte analyse, nous souhaitons questionner les logiques de mobilisation des gens, en agissant PAR, AVEC et POUR eux, dans une logique d’éducation populaire et permanente basée sur les apports de deux penseur·euses du Sud et du Nord de la planète.
 La FUCID
La FUCID
À travers ses analyses et études en éducation permanente, la FUCID ouvre un espace de réflexion collective entre les militant·es du monde associatif, les citoyen·nes du Nord et du Sud et des enseignant·es / chercheur·ses. En multipliant les regards et les angles d’approche sur les questions de société liées à la solidarité mondiale, la FUCID propose de renforcer, au sein de l’enseignement supérieur, la valorisation d’alternatives aux systèmes de pensée dominants.
Être sensibilisé à… ou avoir vécu ?
Si le sentiment de « légitimité » par rapport à l’objet d’engagement ou encore l’impression « d’en faire toujours trop » ou « jamais assez » sont régulièrement identifiés comme « freins » à l’engagement dans les milieux militants ou près des populations déjà fortement sensibilisées, qu’en est-il pour des populations désireuses de s’engager mais n’ayant que peu été sensibilisées ?
Pour d’aucuns, existerait-il une gradation de l’engagement correspondant au·à la « bon·ne » et au « moins bon·ne » engagé·e ?
Par exemple, est-il possible d’œuvrer pour des politiques migratoires plus justes si nous ne sommes pas nous-mêmes migrant·e ?
En effet, une personne engagée dans la lutte des « sans-papiers », réclamant une régularisation massive parce qu’elle est elle-même dans cette situation précaire n’a pas les mêmes enjeux qu’une personne engagée dans cette même lutte mais qui n’y est pas confrontée.
Pourtant, la rencontre de ces deux logiques convergeant collectivement vers le même objectif et est souvent gage de qualité tant dans le processus que dans le résultat. Dans son ouvrage méthodologique d’éducation permanente et populaire « Les intelligences citoyennes »[1], Majo Hansotte nous parle du rapport au vécu et au JUSTE.
À partir d’une situation vécue individuellement comme injuste, d’un « tort subi », comment pouvons-nous collectiviser cette parole (passer du Je au Nous), adopter un point de vue critique et collectif basé sur une réappropriation du contexte, sur la systématisation des expériences individuelles en vue de la construction d’un NOUS.
C’est donc l’expérience, ce qui est vécu d’abord individuellement comme étant juste / injuste, qui est au cœur de ces démarches. De ce point de vue, le dénominateur commun entre une femme qui raconte un vécu de violence conjugale et une autre qui milite dans un collectif contre les violences faites aux femmes, c’est un sentiment intime d’injustice et de révolte. Chaque ressenti et récit est donc légitime à partir de ce que chacun·e vit.
C’est cette impulsion individuelle de départ qu’il est utile de transformer en ressource pour l’action collective. On a besoin de recréer du lien qui débouche sur une action politique. Cette définition collective de ce qui est JUSTE doit alors passer l’épreuve du JUSTE pour NOUS TOU·TES.
Comment passer de l’engagement individuel à la mobilisation collective et à l’organisation politique ?
La mobilisation nécessite le caractère collectif de l’engagement et cela demande, nous l’avons vu, une co-construction d’une vision commune, d’un message, de revendications collectives face aux constats de départ, aux objectifs communs et aux types d’actions choisies.
Ces revendications collectives jugées valables et justes pour nous tou·tes. souhaitent donc tendre vers un processus d’universalisation :
[1] Hansotte, M. (2013). Mettre en œuvre les intelligences citoyennes – une méthodologie de Majo Hansotte, Le Monde selon les femmes, Bruxelles.
« On parle à la fois pour nous, aujourd’hui, demain, ici mais on parle aussi pour ceux et celles qui ne sont pas là ou pas encore là, ou ailleurs… » – Majo Hansotte
C’est cette « convergence des luttes », multiacteur·trices, solidement ancrée dans l’expérience, l’analyse des contextes et enjeux, le positionnement critique qui donne du sens à l’organisation et la mobilisation collective.
Une fois ces questionnements, observations, positionnements et expériences réalisés, ces formes de mobilisations sont « mûres » pour revendiquer leur caractère social et politique.
Nous entrons ici dans la dimension politique de l’éducation populaire et permanente, sur une nécessaire réintroduction du conflit et de la notion de complexité.
« L’enjeu de l’éducation populaire aujourd’hui, au niveau local et mondial, est de permettre aux citoyens et citoyennes d’articuler trois repères, à savoir, l’expérience vécue, l’apprentissage lié à cette expérience et les rapports de pouvoir dont ils/elles sont victimes » – Ibid.
Nous l’aurons compris, ces processus demandent du temps, un personnel formé et une volonté commune.
C’est aussi et surtout la rigueur des processus et méthodes utilisées qui sera gage de crédibilité, de légitimé d’un collectif de la société civile dans un contexte mondial de plus en plus « technocrate », « cloisonné », où les « experts » et les « think tank » semblent avoir le monopole du savoir, de la bonne gouvernance et des solutions adaptées.
Que dire des logiques démocratiques et des besoins fondamentaux dans le processus de mobilisation citoyenne ?
Qu’en est-il des conditions démocratiques permettant ces différentes formes d’engagement ? Qu’en est-il également des différents besoins qui les sous-tendent ?
Dans une perspective d’Education Populaire et Permanente, quels points de repères pouvons-nous tenter d’avoir en tête dans les processus collectifs menant à l’action, au changement social, économique, écologique ou culturel ?
Si nous prenons le point de référence d’une ONG universitaire qui a pour public cible les étudiants, comment pouvons-nous analyser les formes de démocraties vécues par « un groupe à projet » ainsi que les différents besoins à l’œuvre dans le processus d’engagement individuel et collectif ?
José Bengoa, historien et anthropologue chilien, nous propose une grille d’analyse inspirante et innovante sur le lien entre l’Education Populaire et l’action sociale.
Il établit clairement un lien entre la prise de parole publique et collective des publics d’abord au sein de leurs institutions respectives, et ensuite par rapport aux pouvoirs publics et aux systèmes politiques en place.
Ce processus permet de travailler sur les trois niveaux micro-méso-macro. C’est-à-dire favoriser l’acquisition d’une conscience de soi, une conscience de son « groupe d’appartenance » ainsi qu’une conscience politique plus globale.
Nous voyons donc une oscillation nécessaire entre le niveau individuel, collectif et sociétal.
Posons le cadre…
Selon Bengoa, trois sortes de démocraties [2] sont à l’œuvre dans nos sociétés :
— La démocratie formelle qui est fondée sur le suffrage universel, la séparation des pouvoirs et l’alternance.
Elle s’apparente donc à la logique dite « républicaine » puisque les acteurs principaux de cette forme de démocratie sont les partis politiques élus par les citoyens.
— La démocratie fondamentale qui est, quant à elle, fondée sur des préoccupations d’égalité et de solidarité organisées au niveau de l’Etat. Sur une logique de redistribution des richesses. Cette forme de démocratie est donc beaucoup plus interventionniste et son acteur principal est l‘Etat.
Notons qu’une démocratie uniquement formelle sans prise en compte des logiques de solidarité, d’égalité et de redistribution pousse souvent les citoyens « lésés » aux votes extrêmes (de gauche ou de droite) sur l’échiquier politique.
— La démocratie substantielle ou participative. Ce type de démocratie est très souvent associée à celle à l’œuvre dans les mouvements sociaux. L’enjeu est la démocratie « réelle » et le renforcement de la société civile. Elle se situe dans une logique d’Education Populaire et de distribution du pouvoir.
C’est, à priori, dans ce type de démocratie qu’œuvrent les associations de type « socioculturelles » ainsi que les ONG.
Dans ce contexte démocratique, Bengoa identifie quatre besoins fondamentaux à la base de l’engagement social, de la mobilisation citoyenne.
Ces besoins vont donc de pair avec la conception de la démocratie et le degré de mobilisation de la société civile. Ce sont là les fondamentaux du pouvoir d’agir des gens quant au changement social visé. « Toute action sociale tente d’apporter une réponse aux besoins des gens à qui elle s’adresse » [3].
Voyons cela de plus près…
— Le besoin d’identité. « Tout être humain a besoin de savoir qui il est individuellement et quel est son groupe d’appartenance. Ce sont ses besoins d’identité » [4].
Ce besoin de se définir en tant qu’individu, en tant que groupe est primordial. Qui suis-je au sein de mon association, de mon groupe ? Comment ai-je envie de me définir ?
En tant que groupe, comment nous définissons-nous ? Comment allons-nous nous définir face aux autres partenaires du projet, face aux médias ?
Si nous prenons comme repères les nombreux projets collectifs menés par nos ONG universitaires, chaque étudiant·e s’est posé la question de savoir qui il·elle était dans ce groupe ? Comment a-t-il·elle réussit à s’affirmer au sein du groupe ? Comment a-t-il·elle trouvé l’équilibre entre ce qu’il est et sa participation au projet collectif ?
— Le besoin de participation. « Tout être humain a besoin d’améliorer son fonctionnement en groupe ou son fonctionnement comme groupe en tant que collectivité. Cela représente son besoin de participation »[5].
Ce besoin de participation rejoint parfaitement la notion d’utilité que doit ressentir un groupe. En effet, que serait-il sans pouvoir être réellement auteur, acteur de son projet ? Il est fondamental que le groupe puisse se sentir porteur de son projet de la conception à la finalisation. Que le groupe puisse être reconnu capable de décider ce qui est bon pour lui et d’émettre des propositions concrètes.
Un groupe appelé à participer sans avoir, au préalable débattu sur le sens de l’action, sans pouvoir influer directement sur les décisions risque de se voir verser dans l’occupationnel uniquement. Pire, de se voir instrumentalisé.
— Le besoin d’ascension sociale. Il pourrait se traduire par la nécessité d’acquisition de nouvelles connaissances sur une thématique donnée mais également sur l’acquisition d’outils et de technologies adéquats. « Tout être humain a besoin de progresser, d’augmenter ses conditions matérielles de vie, d’avoir une mobilité sociale ascendante sur le plan individuel et collectif. C’est le besoin d’ascension sociale » [6].
Une fois notre groupe au clair avec qui il est, ce qu’il souhaite et aux commande de son projet, il est nécessaire qu’il puisse permettre à ses membres de pouvoir produire du savoir ensemble, de pouvoir prendre leur place dans la société afin d’améliorer leurs conditions de vie.
— Le besoin de changement social. « Tout être humain a besoin d’exercer un pouvoir dans la société, d’être pris en compte, d’avoir un pouvoir décisionnel dans les domaines qui le concernent. Cela implique un changement de position du groupe par rapport aux autres, son évolution en tant que collectif. C’est le besoin de changement social » [7].
C’est le besoin que les membres du groupe ressentent d’avoir pu, au travers de leur projet, participer au changement de la société.
Ont-ils par exemple pu prendre publiquement la parole et porter leur message ? Ont-ils pu négocier la réalisation de leur projet avec les pouvoirs subsidiants ?
Bengoa nous rappelle aussi qu’il est impératif de prendre ces 4 besoins dans leur ensemble. En effet, un besoin doit pouvoir fonctionner avec les trois autres de manière équilibrée sans quoi il faut s’attendre à des dérives.
Tourné à l’extrême, le besoin d’« identité » peut entraîner un repli identitaire, voire du communautarisme.
Le besoin de « participation » sans perspective de changement social et de réflexion critique peut donner lieu au populisme, peut mener à l’instrumentalisation des membres du groupe ou d’une société.
Le besoin « d’ascension sociale » visant uniquement à produire des connaissances sans prise en compte du contexte, du sens de nos actions peut mener au technocratisme. C’est-à-dire un projet de société où l’avis d’experts techniques (conseillers politiques, administratifs, économiques,…) mettant en avant des arguments techniques afin d’influencer les prises de décisions au détriment des facteurs et arguments humains et sociaux.
Et enfin, le besoin de « changement social » sans donner la possibilité aux membres du groupe d’agir à partir de qui ils sont, d’où ils sont, en cohérence avec leurs besoins peut donner lieu au « dogmatisme ».
D’après une étude réalisée sur 4 campus universitaires belges en 2018, il apparaît que pour les étudiant·e·s, les plus grands freins à l’engagement sont le manque de temps, de moyens financiers et de réseaux / connaissances dans le monde militant [8].
Quand on leur demande ce qui les aiderait à s’engager d’avantage, ils répondent, par ordre décroissant : plus de temps, que leurs ami·es s’engagent également, avoir des formations / sensibilisation sur ces sujets organisées par leur Université et enfin, être d’avantage informé sur les différentes façons de s’engager.
Derrière ces indicateurs, quelle lecture pouvons-nous faire ? De quels besoins s’agit-il ?
De manière générale, lorsque nous accompagnons les étudiants, des groupes « mixtes » de population dans un projet, demandons-nous donc si nous avons favorisé leur participation, si nous sommes partis de qui ils·elles sont, leur permettant ainsi de participer à la construction d’un savoir commun en vue d’engendrer du changement social.
Nous ne répondrons pas ici à ces questions qui restent ouvertes mais le travail et les réflexions menées par la FUCID, à l’instar d’autres ONG et associations d’éducation permanente, se trouve enrichit par les grilles de lecture méthodologiques proposées ci-dessus.
Il s’agit en effet de les garder en tête lorsque nous menons nos activités avec les jeunes et les associations partenaires. C’est donc le processus, ou ce que nous pourrions appeler la « praxis », cette forme d’interaction constante entre l’action et la pensée qui doit guider nos pratiques professionnelles.
Il en existe bien sûr beaucoup d’autres tout aussi pertinentes mais celles-ci, en particulier, nous permettre de nous poser des questions essentielles et de porter un regard critique et constructif sur notre propre pratique professionnelle. Ces méthodologies sont également vouées à être enrichies, à évoluer, à vivre avec les enjeux nouveaux et les solutions innovantes à inventer. Partagées en équipe, entre partenaires, elles aident également à réfléchir sur le sens de nos actions et à, encore mieux, agir POUR, PAR et AVEC les gens.
Ainsi, au travers des actions micro que nous menons, nous pouvons jeter les bases d’actions macrosociales. La méthodologie que nous appliquons dans les petites structures est porteuse d’une méthodologie de changements plus globaux. Ensemble et en veillant à cette forme de démocratie participative, les gens sont parfaitement capables de réfléchir, d’analyser une situation vécue et d’agir. Gageons que, nos petites histoires, mises bout à bout, créent la grande Histoire !
[2] Pour aller plus loin : ONG Iteco : J. BENGOA : les trois formes de démocraties et les quatre besoins fondamentaux [powerpoint]. http://www.iteco.be/revue-antipodes/education-au-developpement-etat/Principes-pedagogiques-de-l; http://www.iteco.be/Quatre-besoins-fondamentaux, page consultée le 23 avril 2018.
[3] Idem.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Enquête sur l’engagement des publics universitaires : résultats de l’enquête auprès des étudiants : rapport final – juillet 2018. SONECOM.
Sarah Beaulieu, Chargée de projets en éducation permanente à la FUCID
En savoir +
Découvrez les autres études de la FUCID ici !