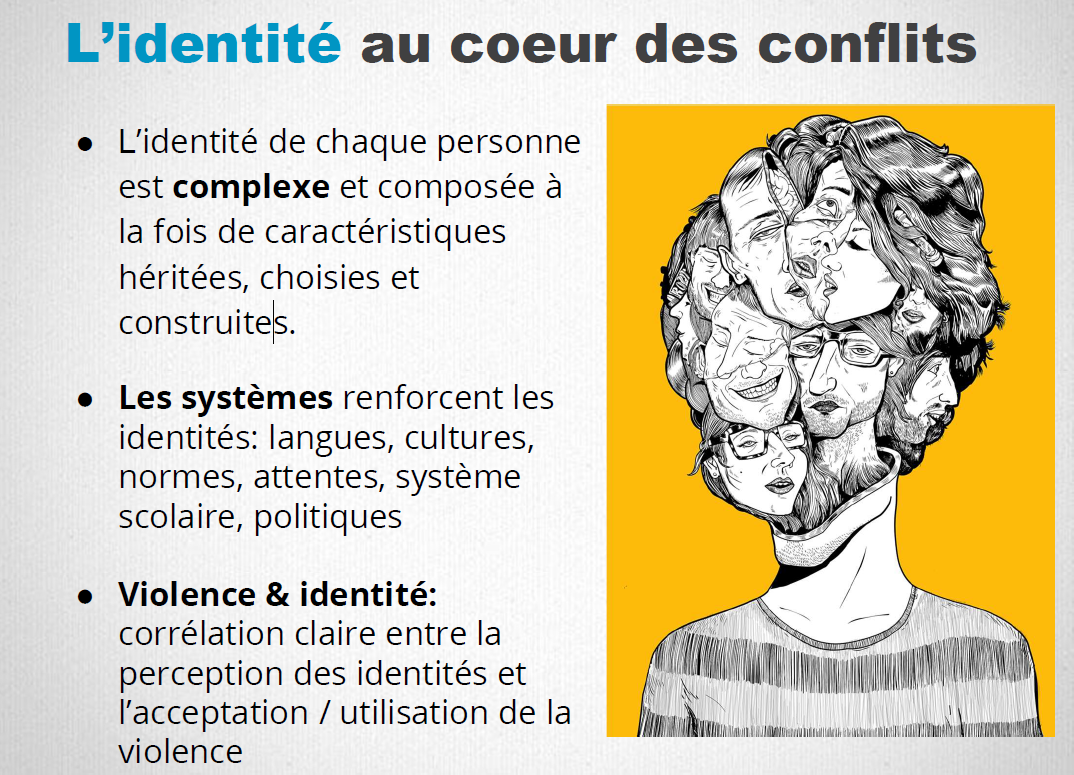Char d’assaut détruit au Soudan du Sud © Wollwerth Imagery – Fotolia
Dans une société post-conflit, il est important de pouvoir rapidement et durablement mettre fin au cercle vicieux ayant mené à la violence. Pour y parvenir, différents mécanismes peuvent être mobilisés parmi lesquels la justice, le travail de mémoire et la restauration de la cohésion sociale. Pris individuellement, ces mécanismes sont nécessaires à la construction d’une paix durable mais insuffisants. Comment ces mécanismes fonctionnent-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques identifiées en la matière ? Quelles sont leurs plus-values et limites ? Comment se renforcent-ils mutuellement ?
Nous avons pu constater ces dernières années que les conflits continuent de faire partie intégrante de l’Histoire du 21ème siècle. Si les conflits se multiplient, ils ont également tendance à prendre des formes de plus en plus nombreuses. Mais qu’importe la forme qu’ils prennent, les conflits ne cessent pas au moment où les armes sont déposées ou les éventuels accords de paix signés. Au contraire, commence alors un travail essentiel de réconciliation afin d’établir de nouvelles bases solides d’une société plus résiliente, pacifique et prospère. Au lendemain du conflit, l’Etat concerné se trouve face à de nombreux défis : garantir la vérité, la justice, la réparation, le travail de mémoire, la restauration de la confiance mais aussi, et surtout, la non répétition. Le processus de réconciliation doit permettre de restaurer les relations brisées, assurer le principe de responsabilité pour lutter contre l’impunité et faire émerger la vérité concernant les violences vécues. L’établissement de la vérité concernant les faits du conflit est un travail indispensable mais délicat qu’il est essentiel de fonder sur le dialogue. Différentes voies peuvent être utilisées pour instaurer ce dialogue. Tout d’abord, la justice (inter)nationale va pouvoir contribuer à restaurer le respect des droits humains en mettant en œuvre le droit des victimes, notamment en leur donnant la parole. Le travail de mémoire va quant à lui permettre d’établir, le plus impartialement possible, la vérité des événements. La parole qui en émergera doit pouvoir être dite et entendue de tous de manière crédible et fiable. Il est en effet capital que les représentations du passé soient acceptées de manière consensuelle afin d’éviter toute remise en question de cette Histoire dans le futur et particulièrement le négationnisme. Le bon déroulement de travail de justice et de mémoire devrait finalement contribuer à reconstruire la cohésion sociale, assurer l’adhésion et l’inclusivité, tant au niveau local que national afin de promouvoir l’apaisement et la réconciliation durables.
Le besoin de justice : articulation entre les justices nationales et internationales et le rôle des victimes
Pour Eric David, professeur émérite de droit international à l’ULB, la justice à l’égard des violences de masse soulève quatre questions. La première consiste à se demander si la justice est une réponse adéquate à l’égard de la violence et des crimes de masse. Dans la mesure où la justice permet aux victimes de survivre, la réponse à cette première question serait plutôt positive. La reconnaissance institutionnelle des crimes commis peut apaiser ou du moins répondre à la douleur. La justice permet en effet de libérer la parole, elle crée une dynamique de groupe et contribue au soulagement des victimes. En somme, elle permet aux survivants de survivre. La deuxième question concerne la réponse à l’indignation publique. Là encore on peut prétendre que la justice permet de répondre à l’indignation publique en servant d’exécutoire, en témoignent les nombreux films consacrés par exemple au procès de Nuremberg. La troisième question porte sur les exigences de mémoire. La justice permet de mémoriser l’horreur, de « briser le silence des cimetières ». Dans le droit anglo-saxon, cette exigence se retrouve au niveau des interrogatoires et contre-interrogatoires. Dans le droit continental, elle se retrouve au niveau de l’audition des parties et de leurs témoins. Ce principe contradictoire doit permettre de rechercher et trouver la vérité mais vise également à exclure toute forme de révisionnisme. L’autorité de la chose jugée devient alors un élément de l’Histoire même s’il arrive que la justice se trompe. En effet, la justice est humaine et donc faillible.

[1] Dans le cadre de la loi du 16 juin 1993, la Belgique a établi les principes de la compétence universelle des juridictions belges pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide, et ce en l’absence de tout lien de rattachement territorial ou personnel avec la Belgique. Cette loi a finalement été modifiée deux fois et abrogée le 5 août 2003 mais la compétence universelle reste applicable en Belgique sur base de certaines dispositions du Code pénal, même si sa portée a été restreinte lors de ces modifications successives. Plus d’informations : https://rcn-ong.be/wp-content/uploads/2020/03/26.-supports-thematiques-la-competence-universelle.pdf.
Finalement, la dernière question concerne le rôle de la justice dans la prévention des crimes. La justice devrait y contribuer mais force est de constater que cela ne fonctionne pas, l’Histoire continue de se répéter malgré les « Plus jamais ça ! ». La réponse à cette dernière question serait donc « non, aucune forme de justice n’a réussi à prévenir les crimes ». La seule chose qui peut prévenir les crimes est la formation et le conditionnement au respect des droits humains. Comment ? En favorisant la mise en place de tribunaux de conscience et d’opinion tels que le tribunal permanent des peuples de la Fondation Lelio Basso ou Monsanto. Ces tribunaux, fruits d’initiatives populaires, sont des formes de libération de la parole et l’expression d’un véritable besoin social.
Mais quid de la place des victimes dans ces mécanismes de justice ?
Michèle Hirsch, avocate spécialiste en droit pénal international et droit des victimes, insiste sur le rôle essentiel que les victimes jouent, particulièrement en matière de justice internationale. En ce qui concerne par exemple le génocide des Rwandais Tutsi, la différence fondamentale entre la justice rendue en Belgique sur base de la compétence universelle [1] et celle rendue par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a été la présence et la participation des victimes. Les victimes ont joué un rôle capital dans le cadre des procès qui ont eu lieu en Belgique.
Le premier rôle des victimes est la recherche des auteurs. C’est grâce aux victimes que les poursuites vont ensuite être possibles. En racontant leur histoire, elles vont permettre de restaurer les faits à l’origine des poursuites. En Belgique, l’obligation de preuve incombe en effet à la partie poursuivante. Les victimes agissent ainsi contre les forces freinantes que peuvent être les forces politiques voire judiciaires.
Les victimes ont également joué un rôle capital en ce qui concerne la qualification des faits. Initialement, en Belgique, la qualification retenue était celle de « crime de guerre ». Les victimes se sont battues pour que la qualification de « crime de génocide », reflétant la réalité factuelle et juridique des faits, soit retenue. C’est également grâce au travail des victimes que le viol a été reconnu par les tribunaux. S’il s’agit d’une réalité dans le génocide des Rwandais Tutsi, ce mot n’est même pas cité dans les premiers procès. C’est grâce aux témoignages des victimes et de leur courage que le terme a été retenu. Sans cela, la réalité des viols n’aurait pas été évoquée.
En outre, la persévérance des victimes a également permis d’assurer que le génocide soit reconnu comme un crime et non pas un délit. En effet, une loi de 2016 demandait aux juridictions de correctionnaliser les faits liés au génocide pour qu’ils ne soient pas jugés devant la cour d’Assise. La Belgique aurait alors été le seul pays au monde à considérer le génocide comme un délit et non comme un crime.
Finalement, les victimes ont également un rôle de transmission car la justice est un vecteur de transmission transgénérationnelle. Ainsi, par leur témoignage, les victimes nous permettent de connaître les faits, l’histoire et donc de lutter contre le révisionnisme. L’oralité des débats nous permet de vivre la réalité et l’horreur vécues par les victimes.
Le travail de mémoire : comment gérer le passé pour apaiser le futur ?
Pour Valérie Rosoux, philosophe et politologue (UCL), il faut être conscient qu’après un conflit, on ne va pas parler en années mais en générations. Chacun porte bien plus que sa propre vie après une guerre. Cette question de la transmission se pose au niveau individuel mais également au niveau politique.
Valérie Rosoux identifie quatre types de guerre :
- La guerre classique, entre Etats, où l’autre est l’ennemi à combattre ;
- La guerre civile où l’autre est un traître à punir ;
- La guerre coloniale où l’autre est un enfant à éduquer ou le barbare à civiliser ;
- Le génocide où l’autre est un animal à exterminer.
Chaque scénario va demander des réponses ajustées tant sur le plan de la justice, de la cohésion sociale que de la mémoire. Pour rétablir des liens, il faut pouvoir comprendre comment ils ont été détruits.
La mémoire est portée par des vents qui vont dans plusieurs directions. Certains vents, puissants, nous ramènent dans le passé, d’autres poussent vers l’avenir. Chaque individu est alors pris dans cette tempête. Il faut donc pouvoir définir un cap pour ne pas se perdre. Il est difficile de se tromper en prenant le cap de la génération suivante, en se disant que c’est le regard des enfants qui compte.
« Redoutez ceux qui vont venir, qui vous jugeront, redoutez les enfants innocents, car ils sont aussi des enfants terribles » Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, 1938
Ce ne sont pas seulement des récits qui sont transmis de générations en générations, ce sont aussi des émotions telles que la honte, la colère, le ressentiment, la culpabilité, la tristesse et l’humiliation. Ces émotions sont souvent directement liées au visage d’un enfant victime ou témoin de la violence. Si les émotions sont transmises sans le récit (car il est inaudible ou indicible), cela peut être dramatique pour les personnes concernées.
Le défi est alors de relier les récits, de ne pas laisser chacun avec sa guerre. Il s’agit d’aider chacun à vivre avec son passé et non sans lui ou contre lui car c’est impossible. Ce travail est crucial pour les victimes mais également pour la société toute entière. Ce qui est en jeu ce n’est pas seulement la résolution de conflit mais c’est la prévention des prochains conflits. Le microbe de la mémoire ronge et atrophie les récits, ce qui aboutit au négationnisme ou à la théorie du complot. Si on ne porte pas attention aux récits, ils finissent en effet par se tordre et à entrer en guerre à nouveau.
S’il faut garder en tête que les faits du passé sont ineffaçables, le sens qu’on leur donne n’est quant à lui jamais fixé. Les récits de mémoire sont souvent divergeant voire contradictoires. Il ne s’agit alors pas de faire un compromis car cela ne fonctionne pas. Madame Rosoux propose alors trois pistes :
- Tabula rasa : c’est tellement compliqué qu’on ne parle pas du passé (dans les manuels scolaires, les discours…). C’est parfois nécessaire mais ça ne suffit pas.
- La juxtaposition : il s’agit de parler des récits et de toutes les interprétations. Aucun groupe de mémoire ne peut être à priori exclus. Ce n’est pas un exercice évident car on arrive très vite à « chacun sa mémoire et sa vérité » ce qui est très problématique.
- Le zig zag : on travaille progressivement pour passer d’une mémoire individuelle à une mémoire partageable par toutes et tous. Il s’agit donc de raconter les torts subis mais aussi les torts commis. Il y a toutefois beaucoup d’obstacles, notamment dans la réception et dans ce que l’on demande aux victimes – l’empathie.
L’élan se casse, nous sommes dans l’impasse, la vie brisée. Mais c’est du droit à la plainte dont il s’agit ici et chaque plainte est une histoire inachevée. On touche ici l’irréversible. Irréversible signifie inachevé et par conséquent que rien n’est tout à fait figé. Pour pouvoir commencer de nouvelles histoires et terminer ces histoires inachevées, peut-être est-il utile d’écouter sans « oui mais… » ou « d’autre part… », sans interrompre ni souci de relier. Juste écouter et se taire. Renoncer au dernier mot et le laisser à l’absent pour l’honorer enfin.
La restauration de la cohésion sociale ou comment retisser du lien dans une société déchirée
Pour Charline Burton, directrice de Search For Common Ground, la cohésion sociale est la colle qui maintient une société unie et qui détermine la façon dont les membres de la société interagissent les uns avec les autres. L’ONG identifie trois niveaux de cohésion sociale. Le premier, l’agency, est la capacité des individus à collaborer, à avoir l’impression de pouvoir être entendus pour influencer positivement la société. La cohésion horizontale désigne quant à elle la capacité à collaborer avec autrui. C’est intimement lié à la question de la confiance que l’on a dans les autres groupes (divisés au niveau religieux, ethnique, historique ou encore de l’accession au pouvoir) et l’envie d’entrer en interaction avec eux. Le troisième niveau, la cohésion verticale, désigne la capacité des communautés à entrer en contact, être respectées et écoutées par les preneurs de décision et autorités.
Pour faire le lien avec les éléments aborder précédemment, il s’agit de se poser les questions suivantes :
- Mémoire : a-t-on la capacité individuelle de parler de nos traumas ?
- Justice : est-ce que l’on connaît nos droits en matière d’accès à la justice et de droit à la réparation ? Est-ce que l’on a confiance en l’autre groupe et en nos institutions ?

Tableau de Louise Bourgeois, 10am is when you come to me « Le thème de la rencontre de ce matin nous rappelle que ces mains qui se rejoignent peuvent également blesser, tuer, torturer. Dans le cadre de guerres internationales, ces mains sont celles de l’ennemi. Dans le cadre de guerres civiles, elles sont celles du voisin voire du frère. » Valérie Rosoux

Tableau de Stefania Infante, Elle, la mère
Search for Common Ground
Mesurer la cohésion sociale
Focus sur le projet « Justice et mémoire » de RCN J&D
Le projet « Justice et mémoire » mené par RCN J&D au Rwanda démontre bien l’interaction entre les trois dimensions. Ce programme vise à faciliter aux populations rwandaises la compréhension et la participation aux procès des crimes commis lors du génocide sur base de la compétence universelle et à favoriser l’intégration des apports de ces procès dans la mémoire de la justice du génocide dans le pays. Après le génocide des Rwandais Tutsi en 1994, la justice a été acceptée comme l’un des outils essentiels à la fois pour la lutte contre la culture de l’impunité et comme un instrument de prévention des crimes de masse et de la restauration de la cohésion sociale. Cette justice s’est déployée au Rwanda à travers la justice classique et les juridictions spécialisées Gacaca mais aussi au niveau international avec le TPIR et dans les pays tiers sur base du mécanisme de la compétence universelle. A ce jour, il y a encore des procédures en cours devant les justices des pays tiers qui continuent, sur base de la compétence universelle, à poursuivre des personnes accusées d’avoir participé au génocide. Ces procédures souffrent d’une double distance (géographique et temporelle) : elles se déroulent souvent à des milliers de kilomètres du Rwanda et interviennent plus de 25 ans après le génocide. Or, les populations rwandaises, les acteurs de la société civile et des médias et même des praticiens de droit et institutions publiques ne disposent pas suffisamment d’informations sur ces procédures que pour être en mesure de les suivre, de les comprendre ou d’y participer. Au final, en l’absence de tout mécanisme d’appropriation des apports des procès internationaux par la population, ces procédures pourraient échapper à la mémoire collective rwandaise et ne seraient dès lors pas susceptibles de produire les effets pédagogiques qu’on pourrait en attendre en matière de prévention des crimes de masse, de promotion de la légitimité de la justice et de reconstruction de la cohésion sociale au Rwanda. Le programme vise à répondre à ces préoccupations grâce à une sensibilisation intensive des populations et acteurs sociaux rwandais.
Les journalistes rwandais sont informés sur le déroulement du procès devant la Cour d’Assise de Bruxelles.
Les populations sont informées sur la condamnation à perpétuité de Théodore Rukeratabaro par la Cour d’Appel de Stockholm.
Si comme dit précédemment nous sommes toutes et tous le reflet de plusieurs générations, nous sommes également composés de multiples identités : religion, langue, vécu, travail, appartenance sexuelle… Il est important de pouvoir trouver les identités communes au sein des divisions. Ces points communs servent alors de point d’entrée pour le rapprochement entre des groupes en conflit.
Trois stratégies peuvent alors être utilisées. La première est le dialogue avec soi et avec les autres. En créant des opportunités de dialogue avec l’autre groupe, il s’agit de lui permettre de comprendre notre vision des choses, notre narratif par rapport à un passé ou un présent. Ce dialogue doit permettre également de créer une empathie mutuelle. Le manque de dialogue est souvent le premier pas vers la violence car cela mène à une déshumanisation. Quand on ne connaît pas les gens, des stéréotypes se créent, puis une déshumanisation et potentiellement de la violence. Ce dialogue peut être mis en place au niveau communautaire mais aussi au niveau structurel et institutionnel. Une autre stratégie consiste à travailler avec les médias. Ces derniers permettent de faire connaître la perspective de communautés qui n’ont pas une voix qui porte, comme par exemple les anciens enfants-soldats. La dernière stratégie est le travail de communauté : permettre à des groupes d’interagir non plus au niveau individuel mais au niveau de la communauté à partir de projets ou de valeurs communes.
Charline Burton précise que, même si un travail est fait au niveau de la cohésion sociale, ce n’est pas pour autant que le conflit s’arrête. Au Sud Soudan [2], l’ONG a observé que le niveau d’acceptation de la violence varie grandement en fonction de la perception personnelle des populations par rapport aux violences en cours. Moins il y a de violence et plus la situation est stable, plus les gens rejettent la violence. Plus la violence est présente, plus les gens la considèrent comme une réponse acceptable par rapport au conflit. En ce qui concerne les identités, on observe que le niveau de cohésion sociale augmente dès lors qu’il y a une plus grande proportionnalité de gens qui déclarent que l’appartenance nationale est plus importante que l’appartenance clanique ou ethnique.
Il est donc capital de ne pas uniquement réfléchir au niveau global mais de bien réfléchir à la vision de chacune des minorités et de chacun des groupes au sein de ces minorités. Quand on renforce la cohésion sociale et les capacités individuelles des gens à réclamer leurs droits, cela crée des perturbations au niveau des communautés et des pays. Quand des gens qui n’avaient pas de droits commencent à en revendiquer, cela crée des perturbations. La cohésion sociale exige également un investissement durable, cela se jouer sur plusieurs décennies. Finalement, les dynamiques de conflit persistent au moment de la mise en place du travail de cohésion sociale, c’est normal et il est important de persister.
Le Professeur Masengesho Kamuzinzi (Université du Rwanda) et membre de l’Association des blessures de la vie, met quant à lui en avant trois attributs clés de la cohésion sociale : la capacité des individus qui vivent ensemble à se connecter (communication, collaboration et compréhension mutuelle), la capacité à se soutenir et à s’associer pour résoudre des problèmes et la capacité à définir et à adhérer à des normes, des valeurs et des règles qui structurent et rendent possible le vivre-ensemble. Une question se pose alors : est-ce que les gens adhèrent à ces espaces de communication, de solidarité et de définition des normes par nécessité ou par contrainte ? Cette nécessité semble bien présente. Par nature, l’humain est attiré par l’autre, qu’il vive en harmonie ou en conflit avec les autres.
En observant la société rwandaise après le génocide, il semblait difficile de demander à des gens de ne pas interagir et de ne pas travailler ensemble. La question la plus fondamentale reste donc celle de ce qui est resté après un drame comme le génocide des Rwandais Tutsi pour lequel une grande partie de la charge est tombée sur la communauté. Dans la société traditionnelle, qui n’était pas structurée par le droit, les différents espaces étaient très développés car le vivre-ensemble dépendait en grande partie de la capacité des gens à résoudre des problèmes localement. La période coloniale a amené un nouveau cadre administratif et de nouvelles lois. Les espaces de communication et de solidarité ont subsisté jusqu’au génocide.
Au moment du génocide, tous les cadres structurants ont été détruits et les communautés villageoises n’avaient donc plus le cadre leur permettant d’assurer le vivre-ensemble. Les individus sont toutefois restés dans le même village et les interactions sont alors devenues conflictuelles. C’est à ce moment-là que le Professeur Simon Gasiberege a lancé le travail de l’association avec la volonté d’aider la population à remettre en place des nouveaux cadres. L’association met ensemble les individus pour qu’ils parlent des problèmes de leur village et qu’ils définissent ensemble la manière de les résoudre et de les dépasser. Des ateliers de sensibilisation et de guérison sont également organisés pour permettre à chacun de partager son expérience et de contribuer ainsi à définir de nouvelles manières de vivre-ensemble.
Reste la question du lien entre le travail de communauté et ceux de justice et mémoire. Ce qui compte le plus pour les communautés dans le travail de justice c’est la vérité dite en public par les témoins des villages. Cela permet à tout le monde de savoir qui est qui et de travailler ensuite les trois espaces. Là où la vérité n’a pas été connue, il est très difficile de travailler la cohésion sociale. En ce qui concerne la mémoire collective partagée, elle est plus compliquée. Il est important de travailler de telle manière que les vérités établies par les historiens soient connues et se distinguent des discours de propagande. Il faut se donner le cap pour que chaque groupe ne puisse pas garder sa propre mémoire. En ce qui concerne les nouvelles générations, il faut leur apprendre à être résilientes, à trouver leur place dans la société.
Nous pouvons ainsi constater que la question de la vérité traverse toutes les dimensions abordées : la justice, la mémoire et la cohésion sociale. Ces dimensions, bien que très différentes, se révèlent donc imbriquées les unes dans les autres. Les notions de participation et de collaboration de tous avec tous (entre individus et entre individus et institutions) semblent également capitales dans ce travail de réconciliation et de prévention de conflit. Même si dans certains cas, certains acteurs jouent un rôle décisif (comme les victimes dans le cas de la justice), ce qui est fait pour créer un avenir est en fait le résultat d’un travail collectif. Mais il s’agit bien évidemment d’un travail de long terme. Les propos récents du Président Kagamé sur la question de savoir comment résoudre toutes les questions autour de ce qu’il s’est passé dans le Kivu après le génocide illustre bien ce problème.
Cet article est rédigé sur base des échanges ayant eu lieu lors du webinaire organisé le 20 mai 2021 par RCN J&D.
Rédigé par Noémie Grégoire, chargée pédagogique RCN J&D
En savoir+
Retrouvez l’offre pédagogique de RCN Justice & Démocratie sur notre site internet :
http://www.rcn-ong.be/-Europe-?lang=fr.
RCN Justice & Démocratie
Boulevard Adolphe Max 13-17 bte 8, 1000 Bruxelles, Belgique
+32(0)2.347.02.70
www.rcn-ong.be