De prime abord, la question du partenariat apparaît éculée, tant elle a été traitée et discutée dans de multiples formes de production… Souvent, la mobilisation du concept s’est faite sous l’appellation générique de « dynamiques partenariales », masquant au passage la réalité d’une pluralité de formes et de dispositifs de collaboration et d’action. Nombre de concepts-parents sont phagocytés par cette appellation générique.
Notre expérience de l’accompagnement de dynamiques partenariales éclaire sur la nécessité de bien distinguer selon qu’on travaille sur des dispositifs de concertation, sur des processus de consultation ou de collaboration entre acteurs. Pour les évacuer et se focaliser sur le partenariat, on peut simplement avancer que ces concepts-parents, tout autant qu’ils sont porteurs de nuances et de spécificités, dans la pratique du terrain se distinguent du partenariat en ce qu’ils concernent plus spécifiquement le niveau micro social. D’autres critères de distinction sont le caractère plus ou moins formel de l’interaction dans la collaboration et la consultation ainsi que la nature moins formelle et relativement peu structurée des liens entre acteurs de la concertation.
De là, et de manière non définitive, le partenariat est une pratique dans laquelle les acteurs, différents par leurs natures, missions, ressources et activités, sont mobilisés dans une démarche à la fois commune et complémentaire, souvent un projet ou un programme de développement, pour les cas à tout le moins qui illustrent cette production, dans le but d’atteindre des objectifs qu’ils se sont fixés.
Il y a pourtant entre cette définition basique et la capacité de saisir les contingences que grèvent chaque partenariat et les difficultés à faire et à monter des partenariats porteurs, un gap, un décalage dont l’explication ne peut être commune. La question essentielle est simple : pourquoi la question du partenariat reste, spécifiquement dans le domaine des rapports entre acteurs du Nord et acteurs des Suds, [souvent] tant problématique ? Pourquoi la difficulté reste pour les partenaires de maîtriser la dimension « relationnelle » dans la construction et le fonctionnement du partenariat ? L’hypothèse que nous formulons est que la maîtrise de la relation partenariale est conditionnée, comme dans toute relation à la volonté des parties de faire œuvre commune, c’est-à-dire de démontrer deux choses essentielles : de la motivation et de la confiance.
Or c’est là qu’est une partie importante du problème : comment mettre en œuvre de façon explicite dans la construction et l’entretien d’une relation partenariale ces deux notions, peu travaillées dans la plupart des approches et des disciplines qui nourrissent le champ de la coopération alors que la question du partenariat l’est par ailleurs peut-être un peu trop ? Cette production vise à rouvrir une entrée abordée par quelques auteurs, mais peu souvent mobilisée dans le champ du développement. Trois grands moments vont permettre d’organiser les réflexions que nous suscitent quelques années d’observation du champ du développement tant au Nord que dans les Suds : d’abord une définition contextualisée des concepts centraux qui, pour nous, conditionnent le « bon fonctionnement » d’un partenariat (confiance et motivation), puis, des développements sur quelques cas pratiques d’observation du fonctionnement des partenariats autour de la confiance et de la motivation des acteurs, et enfin, une proposition des issues possibles des échecs du partenariat : que faire d’une relation partenariale avortée ?
Le partenariat à l’épreuve de la confiance
Sens et portée de la confiance dans la construction d’une relation partenariale
Comme la société, le partenariat est à l’image d’une danse dans laquelle le comportement de chaque protagoniste est le résultat de l’interaction avec un ou plusieurs danseurs, et la dynamique générale de la danse n’est rien d’autre que le résultat des mouvements de chacun des danseurs. Mais ce qui est imperceptible à l’observation, c’est que le mouvement de chacun des danseurs n’est pas isolé de l’ensemble, mais construit et orienté par la motivation de participer et par la confiance aux autres acteurs. Et puis, de manière constante, l’interaction entre deux individus (partenaires) crée une situation de vulnérabilité objective et souvent réciproque (liée à l’incertitude) (TROMPETTE, 2004). Cette vulnérabilité ne peut se résorber que par la « confiance » que les agents réussissent à s’inspirer mutuellement. De là, la confiance peut se définir comme l’assurance que l’autre se comportera bien avec moi. Les partenaires dans une relation de confiance savent donc que chacun se comportera selon les termes du contrat/convention, que ce soit parce qu’il donne les garanties, à priori, qu’il va le faire, parce que l’histoire des relations le démontre, ou encore parce que l’un des partenaires a les moyens de pousser l’autre à bien se comporter. On voit bien que plusieurs modalités peuvent être envisagées dans le processus de construction de la confiance.
Maîtriser le processus de construction de la confiance pour traverser l’incertitude…
On a déjà pu comprendre que la notion de confiance est souvent mobilisée pour rendre compte dans des relations d’échanges et de l’engagement des parties prenantes, notamment dans la situation où cette relation est traversée par l’incertitude. En effet, plusieurs facettes de la confiance sont invoquées dans le cadre de relations fondées sur des mécanismes qui appellent à la régulation. Ces facettes sont les leviers sur lesquels la confiance se construit et se mesure. Pourtant, cette construction n’échappe pas à la tension entre la recherche justement, de la confiance, c’est-à-dire le pari qu’on peut faire dans la perspective de la construction de la confiance, mais aussi en parallèle voire concomitamment, le nécessaire calcul à réaliser en vue de constituer des certitudes avant l’engagement (KARPIK, 2004). Une tension donc, entre abandon, « croyance dans l’intention de l’autre », et contrôle. Mais une tension qui se résorbe par la mise en balance de positions antagonistes qui construisent ou au contraire minent la confiance.
La construction de la confiance comme processus de coréférence… Une observation récurrente des tensions et de la dégradation de la confiance est que les éléments de confiance recherchés par les partenaires sont autoréférentiels (LORENZ, 2004). En lieu et place du questionnement sur les pratiques de l’autre, sur ce qui justifie telle ou telle manière de faire, sur comment l’autre envisage tel ou tel pan de la relation, eu égard à son fonctionnement et ses pratiques. Deux « pièges » sont fréquents : le premier est que le sentiment du partage des références communes entraîne la naissance spontanée de la confiance. Or la confiance est un processus. Le second est qu’elle laisse à la marge la possibilité pour les partenaires de co-référer, c’est-à-dire, de dimensionner la relation en fonction des forces et des faiblesses de chaque partenaire, par l’apprentissage relationnel (idée de la complémentarité, la base même de toute relation partenariale porteuse ; opposition progressivité et spontanéité).
La réputation comme artéfact d’une bonne relation partenariale. À la réputation s’oppose la familiarité. Ces deux modalités éclairent sur la logique processuelle de construction de la relation partenariale. La réputation est fragile. Elle se détruit souvent aussi vite qu’elle ne s’est construite. Elle se heurte dans nombre de cas à l’habileté des organisations à organiser une réputation « artificielle », fragile, simplement parce qu’à priori elle coche toutes les cases recherchées par les partenaires. C’est pourquoi, en lieu et place de la réputation, l’idée est plutôt de travailler la familiarité avec le postulat qu’il n’existe pas une confiance, mais selon les cas, des confiances diverses (à des stades, sur des thématiques, sur des catégories… diverses). La familiarité commande donc de connaître le partenaire dans une pluralité de dimensions et de construire la relation sur ces dimensions. Trois modalités peuvent organiser ce processus (MANGEMATIN, 2004) : d’abord une appréciation du potentiel partenaire parmi un univers d’acteurs concurrentiels. Ensuite, une exégèse organisationnelle et institutionnelle pour apprécier la capacité et les compétences du partenaire à co-porter l’initiative pour laquelle il est sollicitée, et enfin, l’identification d’un positionnement fort de l’acteurs dans son territoire, sur les mêmes thématiques et enjeux, c’est-à-dire, la recherche d’une singularité qui est la preuve d’une authenticité.
Enjeux et déterminants de la motivation dans la construction partenariale
Sens et portée de la motivation dans la construction d’une relation partenariale
On peut difficilement séparer motivation et confiance. Les deux sont imbriqués : souvent c’est la motivation d’un partenaire qui crée la confiance. Parfois, c’est la confiance qu’on lui accorde qui crée la motivation. L’idée ici est de bien rendre compte de cette référence subjective dans la construction et la réussite d’un partenariat. D’autant plus que la motivation n’est pas une donnée, un acquis. Ce n’est pas parce qu’on est acteur du développement qu’on est forcément motivé par toutes les initiatives qui se présentent. L’exemple le plus patent est celui dans lequel l’objet présenté est en désaccord avec les valeurs et l’éthique du partenaire. Exemples : projet autour d’un dispositif d’empêchement physique des migrants par la construction de centres de rétention, projet de planning familial par la stérilisation des jeunes filles… C’est dire que la motivation se construit et s’articule entre l’objet du partenariat et la raison sociale des partenaires. Mais pour essayer de la définir ici, on peut dire que la motivation est la volonté pour les partenaires de s’engager dans un projet commun. Et c’est cette volonté-là qu’il faut aller questionner.
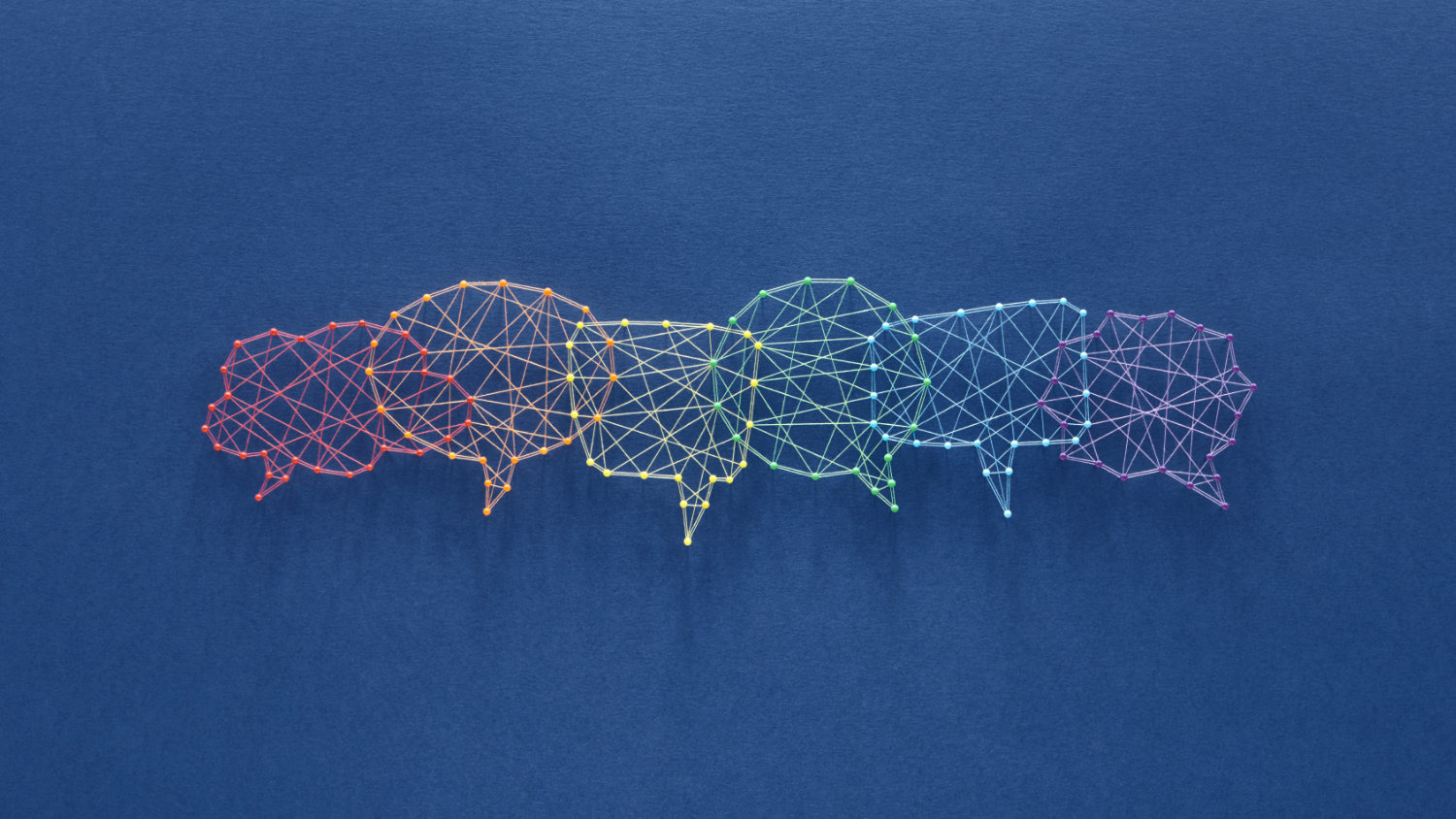
Deux « pièges » sont fréquents : le premier est que le sentiment du partage des références communes entraîne la naissance spontanée de la confiance. Or la confiance est un processus. Le second est qu’elle laisse à la marge la possibilité pour les partenaires de co-référer, c’est-à-dire, de dimensionner la relation en fonction des forces et des faiblesses de chaque partenaire, par l’apprentissage relationnel
Maîtriser le processus de construction de la motivation pour travailler dans le cadre d’un partenariat développemental plutôt qu’un partenariat instrumental
Le postulat que nous posons au départ est le suivant : le partenariat doit être source de développement. C’est-à-dire qu’il doit être construit dans la perspective de participer à une dynamique de développement précise ; le développement (entendu ici dans son acception la plus convenue comme l’ensemble des améliorations/évolutions/progrès d’un territoire et qui illustrent sa croissance aussi bien technique, sociale, territoriale, démographique que culturelle…) doit être la principale motivation d’un partenariat. Or, précisément dans le champ de la coopération internationale, alors que l’on s’attend « naturellement » à ce que le partenariat (tant externe c’est-à-dire se mettre ensemble pour atteindre un objectif commun, qu’interne c’est-à-dire que les partenaires agissent comme miroirs, ils montrent ce qui ne se voit pas, en même temps qu’ils se font sources de renouveau, à la limite ils forcent au changement comme condition pour rester partenaire) soit la source du développement, bien souvent, il est envisagé comme une conséquence, parfois à cause de l’exigence de certains mécanismes de financement. Dans ces cas-là, il est envisagé comme purement conjoncturel.
L’idée est ici de faire la différence entre un partenariat développemental expliqué ci-dessus et un partenariat instrumental, c’est-à-dire cette situation où la motivation d’un ou des partenaires est de réaliser ses propres objectifs, le partenariat lui-même se réduisant au niveau de simple moyen pour réaliser ses ambitions personnelles, et pas le devenir commun porté par toute logique de développement. C’est principalement quand l’entrée/l’angle d’approche de l’analyse ou de la construction de la relation partenariale est orienté sur la motivation que la raison instrumentale peut être« éventrée », tout comme la raison développementale exaltée.
Plusieurs déterminants peuvent éclairer sur les avatars de l’instrumentalisation du partenariat, tant de la part des acteurs du Sud (que De Sardan appelle les courtiers du développement) et du Nord (qu’on peut appeler les néo-colons). En effet, de nombreux acteurs au Sud ont appris à louvoyer avec les attentes des partenaires du Nord, en construisant un discours et un dispositif (structure sociale organisée) qui leur permet de tranquillement capter les fonds de l’aide au travers des relations partenariales, sans que leurs actions, si elles étaient questionnées un tant soit peu par leurs vis-à-vis ne puisse plaider en la faveur d’une volonté de participation au changement. De même, de nombreux partenaires au Nord sont encore dans les approches top-down, et pensent apporter les bonnes manières de faire et de penser les contextes à la place des acteurs locaux. Ce faisant, ils cloisonnent les acteurs mobilisés dans une attitude de collaboration passive qui érode considérablement leur implication dans les dynamiques recherchées. Lors d’une évaluation au Sénégal, le partenaire rencontré avait d’emblée contesté le cadre conceptuel et théorique dans lequel il était mobilisé pourtant depuis plusieurs années. Il lui semblait « incongru » de déployer un dispositif qui recherchait l’égalité entre les hommes et les femmes, alors que le partenaire français avait refusé d’envisager les choses sous l’angle de la complémentarité. De là découle plusieurs enjeux sur la nécessité/obligation de cofinancement, sur l’exigence artificielle de l’implication d’acteurs locaux, sur l’imposition de la pensée occidentalo-centrée, Laplantine par exemple estimant que l’un des enjeux majeurs des sociétés en développement de nos jours est celui de la modernisation sans occidentalisation, et enfin sur le rapport à l’argent. Les partenariats sont aussi une affaire de ressources diverses, soit, celles que chacun apporte, soit, celles que chacun capte du fait même de sa participation. Comment chacun(e) se positionne-t-il par rapport à des ressources qui constituent éventuellement un enjeu stratégique pour l’institution qu’il ou elle représente, à moins que ce ne soit pour lui-même ? On pourrait pareillement soulever celle du rapport au pouvoir.
Faire le deuil d’une relation partenariale avortée (perte de confiance et/ou perte de motivation)
Très souvent, en dehors des précautions non exhaustives que nous avons présentées, les parties s’engagent dans une relation qui se solde par un échec et dont il faut organiser le deuil. Il s’agit, pour rester dans le cadre de nos développements, de deux cas typiques : perte de confiance, et perte de motivation. Que faire dans ces cas-là ? Nous proposons, sur la base de quelques expériences, les façons (non idéalisables) de faire le deuil d’une relation partenariale avortée.
En cas de perte de confiance et/ou de motivation, le plus important est de tirer les enseignements des échecs rencontrés. Partir d’abord de l’idée que l’échec peut-être une issue normale, et qu’il n’y a pas de drame, à priori, qu’une relation ne marche pas ou ne marche plus. Mais il faut surtout se projeter dans le bilan du partenariat échoué. C’est-à-dire, faire le bilan des processus de construction de la confiance et/ou de la motivation en s’appuyant, à minima, sur les grilles présentées ici et en distinguant à chaque fois dans les échecs ce qui est personnel et ce qui est institutionnel. Au-delà de ces éléments, les questions suivantes doivent être posées et documentées : le partenariat est-il équilibré ? Autrement dit, est-il conçu uniquement pour satisfaire les intérêts d’une seule partie ? Qu’attendons-nous vraiment de la différence que les autres nous proposent ? ». En clair, « qu’est-ce qu’on fait pour découvrir et comprendre les différences que l’autre apporte ? » et « quel usage fait-on de cette différence », car bien souvent, la différence est idéalisée. Enfin, le partenariat tel qu’il était envisagé était-il un partenariat engageant ? C’est-à-dire, les partenaires se sentaient-ils dans le même bateau ? La capitalisation des échecs peut apparaître comme une façon de remuer le couteau dans la plaie, mais l’idée est de pouvoir tirer des enseignements sur ce qui a pu se passer afin de mieux avancer. L’idée finale est que les leçons tirées permettent de poser un regard nouveau sur le partenariat en souffrance. Parfois, avec les précautions qu’il faut, il peut être réorienté, réinvesti et limité ou réduit. Dans d’autres cas, les raisons de ne pas coopérer peuvent être si fortes qu’il ne soit pas idéal de continuer.
Bibliographie sélective
TROMPETTE, Pascale. Chapitre 7. De la prudence… à la confiance In : Des mondes de confiance : Un concept à l’épreuve de la réalité sociale [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2004 (généré le 28 avril 2023). Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/editionscnrs/7291 ISBN : 9782271091406
KARPIK, Lucien. Préface. Les fondements symboliques de la confiance In : Des mondes de confiance : Un concept à l’épreuve de la réalité sociale [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2004 (généré le 29 avril 2023). Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/editionscnrs/7282 ISBN : 9782271091406
LORENZ, Edward. Chapitre 8. Que savons-nous à propos de la confiance ? Un tour d’horizon des contributions récentes In : Des mondes de confiance : Un concept à l’épreuve de la réalité sociale [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2004 (généré le 01 mai 2023). Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/editionscnrs/7292 ISBN : 9782271091406
MANGEMATIN, Vincent ; THUDEROZ, Christian. Conclusion In : Des mondes de confiance : Un concept à l’épreuve de la réalité sociale [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2004 (généré le 01 mai 2023). Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/editionscnrs/7303 ISBN : 9782271091406

Marius Rabelai Nkounawa
Directeur d'Inter-Mondes
Marius Rabelai Nkounawa est socio-économiste et démographe, Docteur en sciences politiques et sociales de l’école doctorale des Études du Développement du Royaume de Belgique et du centre des études du développement (DVLP) de l’Université Catholique de Louvain. Il est directeur d’Inter-Mondes. Ses centres d’intérêts sont la gouvernance et les formes de gouvernementalité des territoires, le développement local et infrastructurel, l’agroécologie et l’économie rurale, la formation et l’accompagnement au renforcement de capacités, au renforcement institutionnel et organisationnel. Toutes ces thématiques étant travaillées dans des exercices divers : le suivi-évaluation, l’audit de projets/programmes de développement, des études et capitalisations, l’analyse des politiques publiques ou encore l’accompagnement/formation à des dynamiques rurales et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

